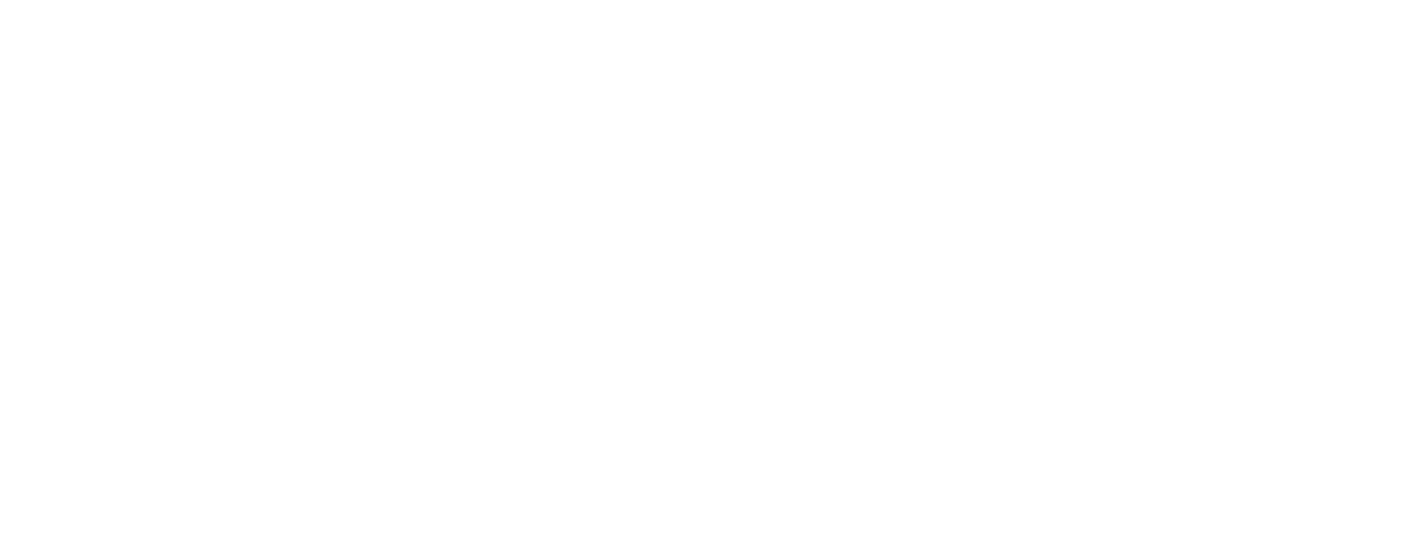Pour analyser plus finement le regard photographique, trois perspectives interconnectées méritent d’être distinguées. La première est le regard du sujet : où le regard se pose-t-il, comment le sujet se présente-t-il dans le cadre ? Un regard direct peut exprimer la confiance ou le défi, tandis qu’un regard détourné suggère le détachement ou l’inconscience de l’observation. La seconde est le regard de l’artiste : il traduit la perception qu’a le photographe du sujet et l’intention avec laquelle il souhaite que le spectateur le perçoive. Le choix du cadrage, de la distance et du moment exact de la prise de vue porte un poids interprétatif considérable. Enfin, le regard du spectateur complète ce triptyque. En observant une image, nous ne nous contentons pas de recevoir de l’information ; nous participons activement à sa construction. La manière dont nous rencontrons le sujet, en lui rendant son regard ou en consommant l’image passivement, boucle le circuit éthique initié par l’appareil.
Historiquement, artistes et spectateurs étaient majoritairement des hommes, un fait qui a profondément façonné la représentation des femmes dans la culture visuelle. Celles-ci ont souvent été positionnées comme objets à regarder plutôt que reconnues comme sujets capables de regarder à leur tour. Ce déséquilibre a installé une tradition visuelle dans laquelle les femmes étaient exposées bien plus qu’autorisées à voir, renforçant des structures de pouvoir genrées qui dépassent largement le cadre de l’image.

Prince Street Girls par Susan Meiselas
L’appareil : un regard qui contrôle
Le simple fait de ne pas vouloir être photographié suffit souvent à faire surgir un véritable inconfort, qui rappelle combien la photographie peut aussi s’inscrire dans des rapports de pouvoir. Photographier quelqu’un, c’est exercer une autorité temporaire sur son apparence, une autorité qui s’étend au-delà de l’instant de la prise de vue et touche tous ceux qui verront l’image par la suite.
Susan Sontag, avec On Photography, reste une référence incontournable pour comprendre ce mécanisme. Elle affirme que photographier, c’est s’approprier le sujet, transformer une personne ou un événement en objet susceptible d’être possédé et diffusé. La photographie n’est presque jamais un acte neutre d’observation : elle est souvent un non-interventionnisme qui, paradoxalement, encourage la persistance de certaines situations, alignant le regard photographique sur le voyeurisme plus que sur l’engagement. L’appareil, sans jamais entrer en contact direct avec le sujet, peut néanmoins influer sur la manière dont il est perçu, interprété ou exposé, tout en maintenant une distance qui tend à en minimiser les conséquences.
Ces questions rejoignent l’analyse de Michel Foucault sur la surveillance et le pouvoir dans les sociétés modernes. Foucault décrit ce qu’il appelle le « regard normalisateur », où la visibilité devient elle-même un outil de contrôle : être vu, ce n’est pas simplement être remarqué, mais être évalué, comparé et jugé selon des critères partagés de normalité ou d’acceptabilité. La photographie participe à ce processus en rendant les individus visibles d’une manière qui invite l’évaluation, consciemment ou non. Si Foucault observait initialement ce phénomène dans des institutions comme les prisons, écoles ou hôpitaux, la logique s’étend désormais au quotidien et aux plateformes numériques, où la production et le jugement des images sont constants. La responsabilité éthique ne relève plus uniquement des autorités ou des professionnels : elle incombe également aux photographes de rue, aux documentaristes et à tous ceux qui créent des images, même involontairement, dans des systèmes de visibilité et de jugement.

Par Bruce Gilden
Participants non invités et éthique de la présence
Observer une photographie impliquant des individus ne se limite souvent qu’au comptage des figures visibles dans le cadre. Pourtant, de nombreuses images contiennent plus de présences qu’il n’y paraît. Dans une image issue de la série Mound Bayou d’Alex Webb (voir ci-dessous), on identifie au premier abord trois personnes, mais il y a aussi une quatrième présence : celle du photographe. Bien qu’absent physiquement du cadre, sa présence se fait sentir à travers la composition et le choix du moment. Demander un consentement explicite au moment de la prise aurait probablement compromis la spontanéité qui confère à l’image sa vitalité. Il existe encore une cinquième présence : le spectateur. Arrivant après coup, il s’immisce néanmoins dans un instant qui n’était pas destiné à lui. Ces présences invisibles nous obligent à interroger la légitimité morale de l’acte de regarder et à mesurer la responsabilité qui accompagne l’observation.
La photographie de rue se situe précisément au croisement de la créativité, de la vie privée et de l’éthique. Son attrait réside dans l’immédiateté, le sentiment de témoigner d’une scène non filtrée et non jouée. Les images posées et consenties peuvent être puissantes, mais l’intensité d’un instant pris sur le vif reste extrêmement difficile à reproduire. En tant que spectateurs, nous avons souvent l’impression de nous immerger, car les sujets ignorent notre présence et ne rompent pas l’illusion d’accès, conférant ce que l’on pourrait appeler un droit de regard sans participation.

Mound Bayou d’Alex Webb
Témoigner sans responsabilité
Cette notion de droit de regard capture une tension éthique centrale. La caméra confère au photographe et au spectateur un droit d’observer sans mérite des moments significatifs, parfois profondément privés ou traumatiques, sans en assumer la responsabilité. L’acte physique de tenir l’appareil crée une barrière qui permet le détachement, transformant l’observation en substitut de l’engagement.
Le travail de Diane Arbus illustre ce malaise inhérent à ce type de témoignage. Au début de sa carrière, elle utilisait la caméra pour surmonter sa timidité et approcher des sujets qu’elle aurait autrement évités. Ses photographies montrent souvent des individus marginalisés fixant directement l’objectif, confrontant le spectateur avec une intensité dérangeante. Sontag critiqua Arbus pour avoir encouragé ses sujets à poser de manière à accentuer leur étrangeté, produisant des images frôlant la caricature plutôt que la compréhension. L’auteur américain Jack Halberstam la décrivait comme « une voyeuse solipsiste plutôt qu’une véritable photographe » et dit de ses sujets qu’ils « paraissent tous étranges et déformés à travers son objectif ». Que l’on partage ou non ce jugement, le travail d’Arbus souligne la fragilité de la frontière éthique entre révélation et exploitation.
Le fait que des figures célèbres comme Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, William Klein, Vivian Maier ou Arbus elle-même aient toutes pratiqué la photographie spontanée ne résout pas ce dilemme. La reconnaissance artistique ne légitime pas rétroactivement les ambiguïtés éthiques et ne signifie pas que ces photographes n’ont pas réfléchi aux implications morales de leurs méthodes.

Par Diane Arbus
Droit, éthique et responsabilité
On affirme souvent que l’espace public est par définition public, ce qui est vrai juridiquement dans de nombreux pays. Aux États-Unis, photographier des individus dans la rue sans consentement est généralement légal, avec certaines exceptions. En France, prendre ces photographies peut être autorisé, mais leur diffusion ou publication est strictement encadrée. La question centrale n’est cependant pas juridique : l’absence de restriction légale ne garantit pas l’absence de préjudice. L’éthique intervient précisément là où la loi s’arrête, interrogeant non pas ce qui peut être photographié, mais ce qui devrait l’être.
Tenir un appareil confère du pouvoir. Le photographe décide quels instants sont préservés, quels visages deviennent visibles et quelles histoires sont renforcées ou passées sous silence. En photographie documentaire, ce pouvoir devient particulièrement sensible : lorsqu’il s’agit de populations vulnérables, le choix du cadrage et du contexte peut soit humaniser, soit réduire à une forme d’exploitation. Une approche éthique suppose de réfléchir à la finalité de l’image : sert-elle à éclairer une situation ? Ou sert-elle à transformer la vulnérabilité en simple objet esthétique ?
Le contexte culturel complique encore ces questions. Dans certaines sociétés, notamment au Moyen-Orient ou en Afrique, la photographie a une dimension symbolique ou spirituelle. Dans certaines communautés, capturer l’image d’une personne peut affecter son âme, son esprit ou son statut social ; photographier sans permission peut alors constituer une violation des croyances religieuses. Pointer un appareil sans consentement y est profondément irrespectueux. L’engagement éthique exige recherche, dialogue et collaboration : il s’agit de créer l’image avec ceux que l’on photographie, de les impliquer dans le processus, d’écouter leur point de vue, de comprendre ce qu’ils acceptent de partager et parfois de les laisser participer à la manière dont ils sont représentés.

Par Vivian Maier
Vers une pratique éthique de la photographie de rue
Même avec les meilleures intentions, des malentendus sont inévitables en photographie de rue. L’éthique ne consiste pas à faire valoir ses droits légaux, mais à maintenir un respect mutuel. La photographie de rue vit de l’imprévu, mais respecter les limites ne signifie pas renoncer à la créativité.
Le travail de Vivian Maier illustre comment l’observation peut coexister avec la dignité. Elle capte des moments authentiques et sans garde, révélant l’émotion avec compassion, sa présence n’est jamais intrusive. Ses autoportraits, souvent visibles dans des reflets alors que d’autres restent au centre, révèlent subtilement sa dualité et enrichissent la lecture de ses images spontanées. Jill Freedman, quant à elle, privilégie l’empathie et le respect, adoptant une approche immersive en vivant au sein des communautés qu’elle photographie. La confiance et la compréhension qui se dégagent de ses images montrent que l’engagement éthique peut approfondir, et non diminuer, la perception photographique.
Le travail de Freedman éclaire aussi les limites de la photographie de rue contemporaine. Si elle reste principalement documentariste, son investissement dans des projets thématiques soutenus contraste avec la tendance de la photographie de rue à capturer des instants publics aléatoires. Son immersion dans des commissariats, des cirques ou des cultures étrangères illustre le type de rigueur et d’attention qui pourrait enrichir la photographie de rue moderne, et pallier l’inconsistance de nombreuses images circulant sur les réseaux sociaux.

Par Jill Freedman
Conclusion : éthique comme conscience et connexion
L’éthique du regard photographique invite le photographe à réfléchir non seulement à ce qu’il voit, mais également à la manière dont il regarde. La photographie de rue ne se limite pas à figer un instant. Chaque image implique un choix : interférer ou observer, exploiter ou honorer, réduire une personne à un simple objet visuel ou reconnaître son humanité entière. Ces choix influencent la perception et la mémoire des vies, des corps et des histoires bien au-delà de l’instant capté.
Photographier confère un droit de regard, une position privilégiée pour observer le privé, le vulnérable, l’éphémère sans conséquence. Mais ce privilège implique une responsabilité éthique : agir avec attention, respect et empathie. L’éthique n’est pas une contrainte, elle aiguise la vision et enrichit le sens. Dans un monde saturé d’images, chaque regard peut soit répéter certaines formes de violence, soit ouvrir un espace de compréhension et de lien. Photographier de manière éthique, c’est choisir d’exercer cette pratique en respectant pleinement l’humanité des sujets et également reconnaître que le regard n’est jamais neutre, pour que l’acte de témoigner devienne aussi un acte d’attention.